Comme promis, voici la suite de notre "petit" tour d'horizon de la Grande Guerre à travers le cinéma et la littérature... Il y aurait bien d'autres points encore à explorer : la peinture notamment... Peut-être l'objet d'un prochain billet qui sait ! Mais pour l'heure, place à la littérature !
LA GRANDE GUERRE DANS LA LITTERATURE
Cette présentation ne se veut évidemment pas exhaustive car très nombreuses furent les oeuvres littéraires liées à la Grande Guerre. Nous nous attacherons donc ici à mettre en exergue certaines oeuvres parues pendant ou au sortir de la guerre et en langue française...
LE POETE ASSASSINE (Octobre 1916) de Guillaume Apollinaire (1880-1918)
Apollinaire fait partie des artistes qui se portent volontaires pour le front, à l'instar de Blaise Cendrars et Henri Barbusse. Il perdra la vie, 2 jours avant l'armistice de la grippe espagnole.

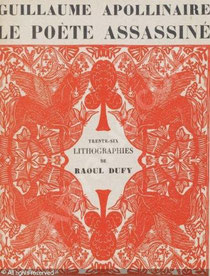
EXTRAIT :
" Dans de grands paysages de neige et de sang il vit la dure vie des fronts ; la splendeur des obus éclatés ; le regard éveillé des guetteurs épuisés de fatigue
; l’infirmier donnant à boire au blessé ; le maréchal des logis d’artillerie agent de liaison d’un colonel d’infanterie attendant avec impatience la lettre de son amie ; le chef de section
prenant le quart dans la nuit couverte de neige ; le Roi-Lune flottait au-dessus des tranchées et criait non pas en allemand, mais en langue française :
« C’est à moi de lui enlever la couronne que j’ai donnée à son grand-père. » ".
Le Poète assassiné, L'Édition, Bibliothèque de Curieux, 1916, coll. Historial de la Grande Guerre © Y. Medmoun.
LE FEU (1916, Prix Goncourt) d'Henri Barbusse (1873-1935)
Engagé volontaire à l'âge de 41 ans, ses combats sur le front jusqu'en 1916 lui inspireront Le feu, récompensé par le Prix Goncourt la même année...


EXTRAIT :
"Ce ne sont pas des soldats, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers, faits pour la boucherie humaine - bouchers ou bétail. Ce sont des
laboureurs et des ouvriers qu'on reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont des civils déracinés. Ils sont prêts. Ils attendent le signal de la mort et du meurtre ; mais on voit, en contemplant
leurs figures entre les rayons verticaux des baïonnettes, que ce sont simplement des hommes.
Chacun sait qu'il va apporter sa tête, sa poitrine, son ventre, son corps tout entier, tout nu, aux fusils braqués d'avance, aux obus, aux grenades accumulées et
prêtes, et surtout à la méthodique et presque infaillible mitrailleuse - à tout ce qui attend et se tait effroyablement là-bas - avant de trouver les autres soldats qu'il faudra tuer. Ils ne sont
pas insouciants de leur vie comme des bandits, aveuglés de colère comme des sauvages. Malgré la propagande dont on les travaille, ils ne sont pas excités. Ils sont au-dessus de tout emportement
instinctif. Ils ne sont pas ivres, ni matériellement ni moralement. C'est en pleine conscience, comme en plein forme et en pleine santé, qu'ils se massent là, pour se jeter une fois de plus dans
cet espèce de rôle de fou imposé à tout homme par la folie du genre humain."
J'AI TUE (1918) de Blaise Cendrars (1887-1961)

Engagé volontaire, au même titre qu'Apollinaire, Blaise Cendrars, amputé du bras droit en 1915, sera nautralisé Français en février 1916. Modigliani peint son portrait, célèbre, en 1917...


EXTRAIT :
"Les camions ronflent. A gauche, à droite, tout bouge lourdement, pesamment. Tout s’avance par à-coups, par saccades, dans la même direction. Des colonnes, des masses s’ébranlent. Tout le tremblement. Cela sent le cul de cheval enflammé, la motosacoche, le phénol et l’anis. On croirait avoir avalé une gomme tant l’air est lourd, la nuit est irresponsable, les champs empestés. L’haleine du père Pinard empoisonne la nature. Vive l’arampn dans le ventre qui brûle comme une médaille vermeille ! Soudain un avion s’envole dans une grande pétarade. Les nuages l’avalent. La lune roule par derrière. Et les peupliers de la route nationale tournent comme les rayons d’une roue vertigineuse. Les collines dégringolent. La nuit cède sous cette poussée. Le rideau se déchire. Tout pète, craque, tonne, tout à la fois. Embrasement général. Mille éclatements. Des feux, des brasiers, des explosions. C’est l’avalanche des canons. Le roulement. Les barrages. Le pilon. Sur la lueur des départ se profilent éperdus des hommes obliques, l’index d’un écriteau, un cheval fou. Battement d’une paupière. Clin d’oeil au magnésium. Instantané rapide. Tout disparaît. On a vu la mer phosphorescente des tranchées, et des trous noirs. Nous nous entassons dans les parallèles de départ, fous, creux, hagards, mouillés, éreintés et vannés. Longues heures d’attente. On grelotte sous les obus. Longues heures de pluie. Petit froid. Petit gris. Enfin l’aube en chair de poule. Campagnes dévastées. Herbes gelées. Terres mortes. Cailloux souffreteux. Barbelés crucifères. L’attente s’éternise.. Nous sommes sous la voûte des obus. On entend les gros pépères entrer en gare. Il y a les locomotives dans l’air, des trains invisibles, des télescopages, des tamponnements. On compte le coup double des rimailhos. L’ahanement du 240. La grosse caisse du 120 long. La toupie ronflante du 155. Le miaulement fou du 75. Une arche s’ouvre sur nos têtes. Les sons en sortent par couple, mâle et femelle. Grincements. Chuintements. Ululements. Hennissements. Cela tousse, crache, barrit, hurle, crie et se lamente. Chimères d’acier et mastodontes en rut. Bouche apocalyptique, poche ouverte, d’où plongent des mots inarticulés, énormes comme des baleines saoules. Cela s’enchaîne, forme des phrases, prend une signification, redouble d’intensité. Cela se précise. On perçoit un rythme ternaire particulier, une cadence propre, comme un accent humain. A la longue, ce bruit terrifiant ne fait pas plus d’effet que le bruit d’une fontaine. On pense à un jet d’eau, à un jet d’eau cosmique, tant il est régulier, ordonné, continu, mathématique. Musique des sphères. Respiration du monde. Je vois nettement un plein corsage de femme qu’une émotion agite doucement. Cela monte et descend. C’est rond. Puissant. Je songe à La Géante de Baudelaire. Sifflet d’argent. Le colonel s’élance les bras ouverts. C’est l’heure H. On part à l’attaque la cigarette aux lèvres. Aussitôt les mitrailleuses allemandes tictaquent. Les moulins à café tournent. Les balles crépitent. On avance en levant l’épaule gauche, l’omoplate tordue sur le visage, tout le corps desossé pour arriver à se faire un bouclier de soi-même. On a de la fièvre plein les tempes et de l’angoisse partout. On est crispé. Mais on marche quand même, bien aligné et avec calme. Il n’y a plus de chef galonné. On suit instinctivement celui qui a toujours montré le plus de sang-froid, souvent un obscur homme de troupe. Il n’y a plus de bluff. Il y a bien encore quelques braillards qui se font tuer en criant : "Vive la France !" ou "C’est pour ma femme !" Généralement, c’est le plus taciturne qui commande et qui est en tête, suivi de quelques hystériques. Voilà le groupe qui stimule les autres. Le fanfaron se fait petit. L’âne brait. Le lâche se cache. Le faible tombe sur les genoux. Le voleur vous abandonne. Il y en a qui escomptent d’avance des porte-monnaie. Le froussard se carapate dans un trou. Il y en a qui font le mort. Et il y a toute la bande des pauvres bougres qui se font bravement tuer sans savoir comment ni pourquoi. Et il en tombe ! Maintenant les grenades éclatent comme dans une eau profonde. On est entouré de flammes et de fumées. Et c’est une peur insensée qui vous culbute dans la tranchée allemande. Après un vague brouhaha, on se reconnaît. On organise la position conquise. Les fusils partent tout seuls. On est tout à coup là, parmi les morts et les blessés. Pas de répit. "En avant ! En avant !" On ne sait pas d’où vient l’ordre. Et l’on repart en abandonnant le sac. Maintenant on marche dans de l’herbe haute. On voit des canons démolis, des fougasses renversées, des obus semés dans les champs. Des mitrailleuses vous tirent dans le dos. Il y a des Allemands partout. Il faut traverser des feux de barrage. De gros noirs autrichiens qui écrabouillent une section entière. Des membres volent en l’air. Je reçois du sang plein le visage. On entend des cris déchirants. On saute les tranchées abandonnées. On voit des grappes de cadavres, ignobles comme les paquets de chiffonniers ; des trous d’obus, remplis jusqu’au bord comme des poubelles ; des terrines pleines de choses sans nom, du jus, de la viande, des vêtements et de la fiente. Puis dans les coins, derrière les buissons, dans un chemin creux, il y a les morts ridicules, figés commes des momies, qui font leur petit Pompéi. Les avions volent si bas qu’ils vous font baisser la tête. Il y a là-bas un village à enlever. C’est un gros morceau. Le renfort arrive. Le bombardement reprend. Torpilles à ailettes, crapouillots. Une demi-heure, et nous nous élançons. Nous arrivons à vingt-six sur la position. Prestigieux décor de maisons croulantes et de barricades éventrées. Il faut nettoyer ça. Je revendique alors l’honneur de toucher un couteau à cran. On en distribue une dizaine et quelques grosses bombes à la mélinite. Me voici à l’eustache à la main. C’est à ça qu’aboutit toute cette immense machine de guerre. Des femmes crèvent dans les usines. Un peuple d’ouvriers trime à outrance au fond des mines. Des savants, des inventeurs s’ingénient. La merveilleuse activité humaines est prise à tribut. La richesse d’un siècle de travail intensif. L’expérience de plusieurs civilisations. Sur toute la surface de la terre, on ne travaille que pour moi. Les minerais viennent du Chili, les conserves d’Australié, les cuirs d’Afrique. L’Amérique nous envoie des machines-outils, la Chine de la main d’oeuvre. Le cheval de la roulante est né dans les pampas de l’Argentine. Je fume un tabac arabe. J’ai dans ma musette du chocolat de Batavia. Des mains d’hommes et des mains de femmes ont fabriqué tout ce que je porte sur moi. Toutes les races, tous les climats, toutes les croyances y ont collaboré. Les plus anciennes traditions et les procédés les plus modernes. On a bouleversé les entrailles du globe et les moeurs ; on a exploité des régions encore vierges et appris un métier inexorable à des êtres inoffensifs. Des pays entiers ont été transformés en un seul jour. L’eau, l’air, le feu, l’électricité, la radiographie, l’acoustique, la balistique, les mathématiques, la métallurgie, la mode, les arts, les superstitions, la lampe, les voyages, la table, la famille, l’histoire universelle sont cet uniforme que je porte. Des paquebots franchissent les océans. Les sous-marins plongent. Les trains roulent. Des files de camions trépident. Des usines explosent. La foule des grandes villes se rue au ciné et s’arrache les journaux. Au fond des campagnes les paysans sèment et récoltent. Des âmes prient. Des chirurgiens opèrent. Des financiers s’enrichissent. Des marraines écrivent des lettres. Mille millions d’individus m’ont consacré toute leur activité d’un jour, leur force, leur talent, leur science, leur intelligence, leurs habitudes, leurs sentiments, leur coeur. Et voilà qu’aujourd’hui j’ai le couteau à la main. L’Eustache de Bonnot. "Vive l’humanité !" Je palpe une froide vérité sommée d’une lame tranchante. J’ai raison. Mon jeune passé sportif saura suffire. Me voici les nerfs tendus, les muscles bandés, prêt à bondir dans la réalité. J’ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, les gaz, les mitrailleuses, toute la machinerie anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. Je vais braver l’homme. Mon semblable. Un singe. Oeil pour oeil, dent pour dent. A nous deux maintenant. A coup de poing, à coups de couteau. Sans merci. Je saute sur mon antagoniste. Je lui porte un coup terrible. La tête est presque décollée. J’ai tué le Boche. J’étais plus vif et plus rapide que lui. Plus direct. J’ai frappé le premier. J’ai le sens de la réalité, moi, poète. J’ai agi. J’ai tué. Comme celui qui veut vivre.
Nice, 3 février 1918"
LES CROIX DE BOIS (1919, Prix Femina-Vie Heureuse) de Roland Dorgelès (1885 - 1973)
Réformé à deux reprises, pour des raisons de santé, Roland Dorgelès arrive finalement à s'engager. Après plusieurs combats il entre au Canard Enchaîné dans lequel il fait paraître un premier roman satirique ainsi que plusieurs articles. En 1919, son roman Les croix de bois lui vaut le prix Femina - Vie Heureuse et il frôle le Prix Goncourt qui finalement est remporté par A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust.

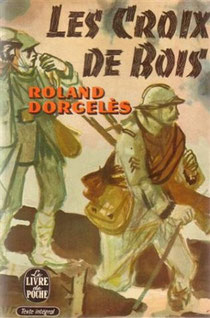
EXTRAIT
"Mourir pour la Patrie
Non, c’est affreux, la musique ne devrait pas jouer ça…
L’homme s’est effondré en tas, retenu au poteau, par ses poings liés. Le mouchoir, en bandeau, lui fait comme une couronne. Livide, l’aumônier dit une prière, les yeux fermés pour ne plus voir.
Jamais, même aux pires heures, on n’a senti la Mort présente comme aujourd’hui. On la devine, on la flaire, comme un chien qui va hurler. C’est un soldat, ce tas bleu ? Il doit être encore chaud.
Oh ! Être obligé de voir ça, et garder, pour toujours dans sa mémoire, son cri de bête, ce cri atroce où l’on sentait la peur, l’horreur, la prière, tout ce que peut hurler un homme qui brusquement voit la mort là, devant lui. La Mort : un petit pieu de bois et huit hommes blêmes, l’arme au pied.
Ce long cri s’est enfoncé dans notre cœur à tous, comme un clou. Et soudain, dans ce râle affreux, qu’écoutait tout un régiment horrifié, on a compris des mots, une supplication d’agonie : « Demandez pardon pour moi… Demandez pardon au colonel… »
Il s’est jeté par terre, pour mourir moins vite, et on l’a traîné au poteau par les bras, inerte, hurlant. Jusqu’au bout il a crié. On entendait : « Mes petits enfants… Mon colonel… » Son sanglot déchirait ce silence d’épouvante et les soldats tremblants n’avaient plus qu’une idée : « Oh ! vite… vite… que ça finisse. Qu’on tire, qu’on ne l’entende plus !… »
Le craquement tragique d’une salve. Un autre coup de feu, tout seul : le coup de grâce. C’était fini…"
CIVILISATION (1918, Prix Goncourt) de Georges Duhamel (1884-1966)
Réformé par l'armée pour des problèmes de vue, Georges Duhamel s'engage malgré tout, en tant que médecin pendant la Première Guerre Mondiale, tout près du front.

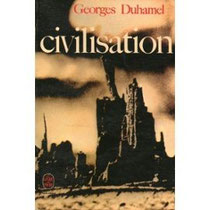
EXTRAIT :
"Je hais le XX e siècle, comme je hais l'Europe pourrie et le monde entier sur lequel cette malheureuse Europe s'est étalée à la façon d'une tache de cambouis."
LES SILENCES DU COLONEL BRAMBLE (1918) d'André Maurois (1885-1967)
André Maurois, de son vrai nom Emile Salomon Wilhelm Herzog fut interprête militaire pendant la Première Guerre Mondiale. Il doit son pseudonyme à un village du nord de la France. Les silences du Colonel Bramble est son premier ouvrage.

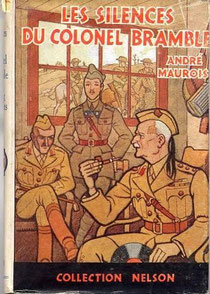
EXTRAIT :
"Quand le jeune lieutenant Warburton, commandant par intérim la compagnie B des Lennox Highlanders, prit possession de sa tranchée, le capitaine qu’il venait relever lui dit : « Cet endroit n’est pas trop malsain ; ils ne sont qu’à trente yards, mais ce sont des Boches apprivoisés. Si vous les laissez tranquilles, ils ne demandent qu’à ne pas bouger.
— Nous allons réveiller un peu la ménagerie, dit Warburton à ses hommes, quand ce guerrier pacifique eut disparu.
Lorsque les fauves trop bien nourris se transforment en animaux domestiques, quelques fusées bien appliquées en refont des brutes : c’est en vertu de ce principe que Warburton s’étant armé d’une fusée éclairante, au lieu de la lancer verticalement, la lança en flèche vers les tranchées allemandes.
Un guetteur saxon, affolé, cria : « Attaque par liquides enflammés ! » Les mitrailleuses boches se mirent à bégayer. Warburton, enchanté, riposta à coups de grenades. L’ennemi appela l’artillerie à la rescousse. Un coup de téléphone, une averse de schrapnells et représailles immédiates de l’artillerie britannique.
Le lendemain, le communiqué de l’état-major allemand disait : « Une attaque, effectuée sous le couvert de liquides enflammés par les troupes britanniques, à H…, a été complètement enrayée par nos feux combinés d’artillerie et d’infanterie."
PETIT BONUS !
LES CORRESPONDANCES D'ECRIVAINS PENDANT LA GUERRE 14-18
Voici quelques lettres d'écrivains célèbres durant la première guerre mondiale. Vibrants témoignages de l'histoire, ce sont aussi de précieux fragments de l'intimité d'auteurs tels qu' Alain-Fournier, hélas mort à la guerre, Guillaume Apolinnaire, qui a survécu à la guerre mais fut emporté par la grippe espagnole en 18, Henri Barbusse et tant d'autres encore...
Lettre de Guillaume Apollinaire à Lou (8 mai 1915)
"8 mai 1915.
Non, ptit Lou, il y a sur la bague quelque chose de plus gentil encore et c’est « Je t’aime, Lou. » Ta carte d’aujourd’hui est plus courte mais plus pleine
de choses exquises que certaines lettres plus longues. Mon chéri, je t’écris chaque jour et quand t’ai pas écrit un jour te le dis le lendemain ― mais t’écris chaque jour. Mon ptit Lou
chéri, je ne te boude jamais, jamais, tu le sais bien, mon amour très chéri, ma Lou. J’écris la lettre avant la venue du vaguemestre, s’il rapporte le mandat il sera dans cette lettre, sinon le
mettrai demain.
Je suis peut-être stupide quelquefois, mais toi tu es parfois bien méchante ― Tant mieux pour l’histoire du dentiste ―
Explique-moi. Mais explique-moi toujours tout, mon chéri, je ne sais pourquoi, tu te méfies de moi, ou te froisses, faut pas, faut pas. Tu sais bien, j’espère, que je t’aime vraiment, pas
banalement. ― Tu dis que tu m’aimes, alors, laisse-toi aller gentiment à mon amour. Tu te laisses aller à celui de Toutou, laisse-toi aussi aller au mien. Puisque tu dis qu’il m’aime bien,
et que tu sais que je l’aime aussi, alors laisse-toi aller gentiment à ce double amour. Mais non, il faut tout le temps te repêcher, te reprendre, tu fuis, on dirait parfois que tu es mécontente
d’être aimée. Puis, c’est tout à coup un mot délicieux comme celui d’hier ― A propos, mets la date plutôt que le jour ― et quand tu n’écris pas, avertis dans la lettre suivante. D’autre
part, comme les endroits où je passe sont de plus en plus arrosés ― si par hasard ― faut penser à tout ― tu recevais une nouvelle peu amusante à mon propos ― n’en dis
rien ― comme ça tu pourras rester tranquillement dans le pigeonnier. Envoie-moi d’autres photos de toi, mon chéri, ça ne fait rien si tu n’es pas seule ― Plus j’aurai d’images de mon Lou,
plus je serai content ― Envoie pas la bi-oxyne ― me la procurerai autrement.
Hier, nuit, allant à la batterie, dans un bois, un poilu débouche sur moi, je le vois quand il est sur moi. En temps ordinaires, dans ces
cas-là, au coin d’un bois, on s’entend demander « La Bourse ou la Vie. » Pas du tout. C’était un poilu qui voulait me demander de faire toucher par le vaguemestre un mandat qu’il m’a
confié. Amusante image de la guerre.
Envoie vite la mesure de la bague ― mais garde aussi la première.
Chérie, aujourd’hui, grande sensualité ― te désire beaucoup, beaucoup, très, très excité ― Ai regardé longtemps la petite photo où
t’es dans l’herbe, visage tourné à gauche de profil, un beau bras nu jusqu’au coude et un air de jouir, de jouir ― Tu es ravissante dans ce petit tableau exquis et je voudrais bien t’avoir,
nue, ton joli derrière bien en l’air, bien obéissante… Je t’adore, mon petit chéri. ― Il y a maintenant dans notre forêt beaucoup de douleurs et aussi de maux d’yeux. ― Les hommes
pensent beaucoup à leurs femmes et j’entends beaucoup parler de faire menotte…
Moi, chérie, j’obtiens par la force des choses une grande perfection de mœurs qui résulte du genre et de la règle de ma vie actuelle.
J’apprends à ne compter que sur moi-même, à ne jamais demander conseil à personne, à toujours prévoir les conséquences d’un acte. Cela ne m’empêche point d’ailleurs d’être un imaginatif, un
poète, et peut-être même parfois et en certaines choses un névrosé, comme toute ma génération née et élevée dans le siècle de l’extrémité et de l’activité vitale excessive.
T’adore, t’adore, t’adore, t’adore.
Gui."
Guillaume Apollinaire, Lettres à Lou, Gallimard, Collection de l'Imaginaire, 2004, pp.351-352
Lettres de Jacques Rivière et Alain Fournier
Lettre d'Henri Barbusse à sa marraine (1915)
"Ma chère marraine,
J’ai la pipe. Elle m’est arrivée dans sa petite boîte côte à côte avec le tabac que peu à peu elle absorbera. Cette pipe me paraît être tout simplement parfaite. Cette perfection même m’empêche d’en parler longuement ; je ne pourrais lui consacrer que des exclamations successives, sur sa forme, son goût et ses dimensions !
Ce qui est non moins parfait, c’est la rapidité avec laquelle cette pipe est venue à mon premier appel. J’en serais émerveillé si je n’étais habitué de votre part, à ces prodiges d’empressement et d’amitié.
Pas de nouvelles nouvelles. On se prépare toujours à quelque chose d’important et de péremptoire. Seule la date de cette action reste encore incertaine.
Si vous avez un chandail, ma chère amie, envoyez-le moi, mais dans ce cas seulement – car j’en ai en dépôt que je pourrais réclamer s’il était nécessaire. Il n’y a donc pas lieu de faire une dépense, vous saisissez ?
D’autant plus que je ne porte point ce vêtement dans le civil. Dans le civil où il faut espérer qu’on finira tout de même par rentrer !
Bien affectueusement à vous,
Henri Barbusse"
Lettre de Maurice Genevoix (1915)
"Cette guerre est ignoble : j’ai été, pendant quatre jours,
souillé de terre, de sang, de cervelle. J’ai reçu à travers la figure un paquet d’entrailles, et sur la main une langue, à quoi l’arrière-gorge pendait... [...] Je suis écœuré, saoul d’horreur.
"
(Citée dans Les Eparges (1923), Ceux de 14 (1949), Flammarion, 1990, p. 614.)
Lettre de Fernand Léger à Louis Poughon (30 octobre 1916)
« Les débris humains commencent à apparaître aussitôt que l’on quitte la zone où il y a encore un chemin. J’ai vu des choses excessivement curieuses. Des têtes d’hommes presque momifiées émergeant de la boue. C’est tout petit dans cette mer de terre. On croirait des enfants. Les mains surtout sont extraordinaires. Il y a des mains dont j’aurais voulu prendre la photo exacte. C’est ce qu’il y a de plus expressif. Plusieurs ont les doigts dans la bouche, les doigts sont coupés par les dents. J’avais déjà vu cela le 13 juillet en Argonne, un type qui souffre trop se bouffe les mains. Pendant près d’une heure avec des attentions de chaque minute pour ne pas me noyer (car tu n’ignores pas que de nombreux blessés meurent noyés dans les trous des 380 qui ont 3 mètres de profondeur et pleins d’eau). [...] Il faut savoir ces choses-là. »
(Fernand Léger, une correspondance de guerre, Les Cahiers du Musée national d’art moderne, Hors série / archives, 1997, p. 66.)
Lettres de Georges Duhamel et sa femme Blanche (Décembre 1915)
Georges, 29 décembre 1915 :
« Mon cher petit Blan. Au moment de la déclaration de guerre, tu as eu une parole pleine de caractère et que
je me rappelle. Tu as dit : « je ne suis pas fâchée d'avoir à me mesurer avec de grands évènements. »
Eh bien voici dix-huit mois de passés. Les grands évènements sont venus. Nous sommes parmi ceux qu'ils ont le moins frappés. Tu sais cela aussi bien que moi et comment une grande chance nous
permet d'arriver à cette époque en n'ayant qu'un cher ami à pleurer, alors que toutes les familles sont diminuées, alors que tant d'hommes survivent au prix d'une infirmité pénible ou même
incompatible avec le bonheur.
Il est vrai que nous subissons une séparation qui est pour nous deux un réel supplice, mais la certitude qu'un haut devoir commande cette séparation permet de regarder en face les heures les plus
dures.
[...]
Ton Georges »
Blanche, 30 décembre 1915 :
« Mon Georges chéri. Tu me reproches, mon amour, ma tristesse en ce moment. Comment veux-tu qu'il en soit
autrement. N'ai-je pas bien des raisons pour me tourmenter et quand je pense que tu es, relativement aux autres, à l'abri je me considère comme étant bien heureuse. Je me demande comment les
autres peuvent supporter cette inquiétude.
[...]
Mon Georges chéri que je te voudrais, que je voudrais appuyer ma tête sur toi. Je me rappelle aussi le jour où j'avais du chagrin, une gronderie d'Antoine [leur fils] et où tu as mis ma tête sur
ton épaule, en me disant que c'était là, maintenant que je devais pleurer. Il y a bien longtemps. Depuis j'ai retrouvé bien souvent cette place. Nos bonheurs, nos chagrins tout ne fait qu'un
depuis longtemps et maintenant je suis loin de toi et je ne sais plus où appuyer ma tête. »
Et pour terminer, une magnifique chanson de Juliette en duo avec le regretté Guillaume Depardieu...
Une lettre oubliée.

Écrire commentaire